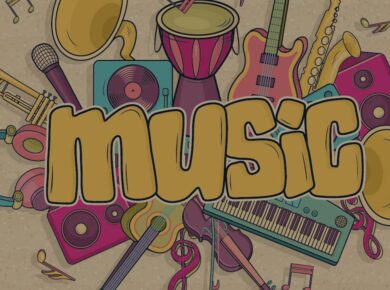Créé en 1969, le Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (FESPACO) est l’un des événements les plus emblématiques du cinéma africain. Il se tient tous les deux ans dans la capitale du Burkina Faso. Bien que son objectif soit de promouvoir les cinémas africains, le FESPACO n’a jamais réussi à résoudre trois problèmes fondamentaux de l’industrie cinématographique africaine :
Le financement et l’accès au public
Une dépendance aux financements étrangers La plupart des films présentés au FESPACO sont financés à 80-100 % par des sources non africaines.
Ces financements, souvent issus de partenariats internationaux, influencent les thématiques des films et les éloignent parfois des réalités locales. Par ailleurs, le succès des œuvres africaines semble dépendre davantage de leur réception internationale que de leur impact sur les publics africains eux-mêmes. Cette situation souligne la dépendance chronique de l’industrie cinématographique africaine envers des acteurs extérieurs, tant pour la production que pour la distribution.
Une gestion opaque et problématique
Le FESPACO reflète également les dysfonctionnements structurels de l’industrie cinématographique subsaharienne. Malgré un demi-siècle d’existence, il est presque impossible de mener une étude exhaustive sur son impact économique en raison d’un manque de transparence financière. Les documents comptables du festival ne sont pas accessibles au public, et il n’existe aucune traçabilité de la billetterie. Cette opacité suscite des interrogations sur l’utilisation des fonds, qu’ils proviennent de subventions publiques, d’aides internationales ou de sponsors privés.
Absence de données
L’absence de données claires nuit à la crédibilité du festival et complique son développement durable. Par exemple, les partenaires internationaux et les sponsors hésitent à investir davantage dans un événement dont l’impact et la gestion restent difficiles à évaluer. De même, les cinéastes locaux, qui pourraient bénéficier du FESPACO comme tremplin, se trouvent limités par l’absence de retombées concrètes sur le développement de l’industrie cinématographique africaine.
Certains attendent du cinéma noir une certaine esthétique “africaine” ou “authentique” renforçant des attentes post-coloniales : misère, spiritualité, exotisme. Toutefois, la reconnaissance ne doit pas
Afro-cinéma & Black Cinéma by Emilie Gredat
entraîner une assignation identitaire esthétique.
src : les cinémas d’Afrique subsaharienne francophone by Ahmat D. Alifa