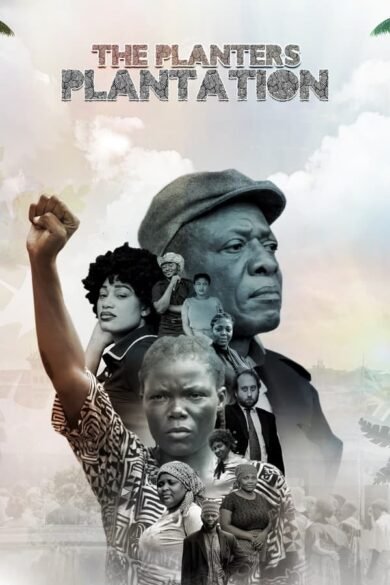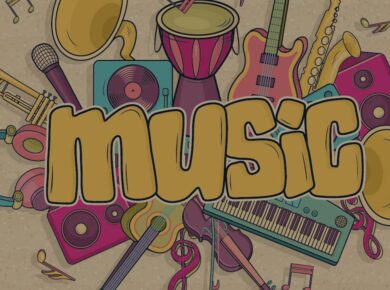Il y’a des films qui restent, il y’a des films qui se dissipent dans les heures qui suivent leur vision.
Marguerite Duras
C’est comme ça que je sais, être allé au cinéma : le lendemain, ce qu’est devenu pour moi le film vu la veille, son état après la nuit, c’est le film que j’aurai vu. Quelquefois, des films se déclarent deux mois après. La plupart des films se perdent. Il y’a des films qui ne bougent plus, comme, pour moi comme le premier American Graffiti (G. Lucas, 1973) dès que je l’ai vu jusqu’à aujourd’hui , une joie : cinéma comme on dit : musique.
Qu’est ce qui est le plus décisif ? L’effet immédiat du film sur moi, à savoir le plaisir comme critère absolu du film, mais lié à l’instant et à la vision du film, ou bien ce qui reste du film, indépendamment du plaisir que celui-ci peut avoir suscité et qui reste secondaire, donc qu’il y ait eu non plaisir et que celui-ci ait été intense ou non?
Si du film, il ne reste rien que le souvenir du plaisir, comme si le film était un prétexte, comme si le plaisir avait été gommé du film, quel sens a l’évaluation ? Du film je dis quoi et je me souviens de quoi??
Le critère qui importe semble donc être, plutôt que le plaisir, le fait que le film marque ou inscrit son empreinte sur celui qui l’a vu. Le critère est moins le plaisir que le souvenir du film: ce qu’il en reste. Ce qui est décisif n’est pas l’instant, mais la longue durée, ce n’est pas un pur présent délié de tout rapport avec un futur, c’est au contraire la continuité par laquelle un moment singulier s’inscrit et se grave dans la vie de l’individu et en détermine l’avenir.
On comprend mieux pourquoi le non-plaisir peut être quelque chose de déterminant et peut avoir davantage de valeur que certains plaisirs. Il arrive que des films aient produit, la première fois qu’on les voit, du déplaisir et de l’irritation. On peut l’expliquer de deux manières.
La première est la réaction commune lorsqu’on voit enfin un film systématiquement cité comme un chef-d’œuvre de l’histoire du cinéma. Le déplaisir ici est lié a une déception relative à la disproportion entre l’attente et son remplissement lors de la vision du film, disproportion souvent liée au fait qu’on reste incapable de comprendre ce qui a pu faire en son temps la nouveauté du chef d’œuvre.
C’est la réaction-type de l’étudiant à la première vision de Citizen Kane, Quartier Mozart ou encore le Mandat de Sembene Ousmane. Qui ne peut être corrigée que par un regard capable, pour comprendre l’engouement qu’a pu susciter ces films et les prestiges qu’ils possèdent, de sortir d’une vision naïve: si on s’attendait a un chef- d’œuvre, c’est déjà qu’on ne regarde pas le film comme s’il était un film comme les autres. Mais que notre regard est médié parce qu’en dit l’histoire du cinéma. Mais, du coup c’est avec les yeux de l’historien du cinéma qu’il faut regarder ces films.
Quant à la seconde manière de comprendre qu’un film puisse marquer malgré le déplaisir, elle est encore liée d’une autre façon à une disproportion entre l’attente et son remplissement. Elle correspond au cas où l’on découvre quelque chose de nouveau, un film météore qui ne correspond à rien, sport parce qu’il relève d’un genre ou d’un sous-genre qu’on ne connaît pas, soit parce qu’il invente ( d’une manière relative ) un sous-genre, de sorte que le film ne propose pas ce que qu’on pensait y trouver. C’est le cas d’Augures de Balodji
Dès lors la raison qui fait qu’on n’éprouve pas de plaisir, c’est l’incompréhension, c’est à dire l’incapacité à donner du sens au film qu’on regarde. Cependant, voilà qui ne veut pas dire catégoriser, c’est aimer : la catégorisation au sens large d’une détermination (à quelle logique obéït le film ?), dont on a vu qu’elle est indissociable de l’attente, est simplement une condition négative du plaisir d’une part, et, d’autre part, il n’est pas évident qu’il faille fonder l’évaluation sur le plaisir (ou du moins sur le plaisir ainsi entendu, c’est à dire le plaisir éprouvé lors de la vision du film).
En somme, le déplaisir est le propre de la découverte. Découvrir est toujours se trouver face à quelque chose qui résiste, où on ne saisit pas tout, de sorte que le plaisir, s’il peut y en avoir, est fortement mêlé de déplaisir. Partant, le plaisir est lié à une familiarité qui fait que le film, qui peut ne pas produire de plaisir la première fois, en suscite lorsqu’on le revoit, lorsqu’on le connaît, c’est-à-dire lorsque, en un mot, on sait ce qu’il y a à voir et qu’on est moins attentif à ce qui est montré qu’à la manière de montrer.
Src : Philosophie du beau au cinéma, Dufour Eric